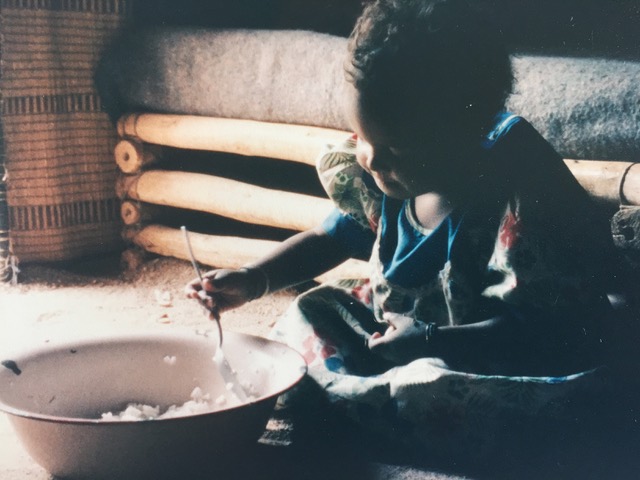
APPEL À CONTRIBUTION | CARGO 16 :
« Inscrire les enfants au cœur des traditions anthropologiques »
Dossier coordonné par :
Fernanda Bittencourt Ribeiro, Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brésil)
Cristina Figueiredo, EDA/Université Paris Cité
Stéphanie Rubi, Cerlis/Université Paris Cité
Alice Sophie Sarcinelli, Cerlis/Université Paris Cité
Modalités et agenda
Le titre, le résumé (10 à 15 lignes), et les mots-clés de l’article doivent être soumis en français ou en anglais aux coordinatrices du dossier (alice.sarcinelli@u-paris.fr) et aux rédacteurs en chef de la revue (cargo.canthel@gmail.com) avant le vendredi 27 mai 2025. Les contributeurs et contributrices sélectionnés seront prévenus avant le 30 juin 2025.
Les articles, en français ou en anglais, devront faire entre 30 000 et 50 000 signes espaces compris, en incluant la bibliographie, et pourront inclure des illustrations libres de droit. La première version de l’article sera à soumettre à l’équipe éditoriale pour le 29 septembre 2025. La deuxième version, révisée en fonction des commentaires de l’équipe, sera à soumettre pour l’évaluation en double aveugle pour le 30 novembre 2025.
Résumé
L’anthropologie de l’enfance se trouve à double titre invisibilisée car elle se distingue des sciences qui se sont davantage appropriées le monde des enfants, comme la psychologie et la psychanalyse, et est encore peu considérée par sa propre discipline.
Pourtant, en 1981, un article majeur de Suzanne Lallemand et Guy Lemoal, révélait déjà la négligence autour d’ « un petit sujet », petit tant par les acteurs concernés – les enfants- que par le peu de place qu’on accorde à cette thématique. Dans les années 2000, d’autres chercheurs considèrent que l’anthropologie a négligé les enfants (Hirschfel 2003, Lenclud 2003), alors qu’on trouve de nombreux anthropologues, dès l’aube de la discipline qui ont interrogé les savoirs dominants autour de l’enfance (e.g. Malinowski, 1927, 1929 ; Mauss 1994(1937) ; Mead, 1928).
La discipline historique a également contribué à la naissance des nouvelles approches de l’enfance en sciences sociales (Becchi et Julia 1998 ; Dasen et al. 2001 ; Dasen, 2001 ; Ariès 1960), DeMause, 1974, Zelizer 1994, Pollock, 1983). Les représentants de ces courants nouent des collaborations fructueuses débouchant sur des travaux d’anthropologie historique (Viazzo 2004).
Le tournant anthropologique des années 1980 a ainsi fait une véritable place aux recherches sur les enfants permettant d’affirmer, quelques années plus tard, que l’enfance fait désormais partie « de la boîte à outils classique de l’ethnographe » (Bonnet 2012, p. 253).
Si aujourd’hui « on ne doit plus se préoccuper de légitimer » un champ dès lors consolidé (Cruz Rifiotis et. al 2021), il reste possible d’approfondir le regard sur ce champ de recherche car un aspect est encore trop souvent passée sous silence : les enfants, en tant que génération suivante, fabriquent et interprètent les normes, et participent activement à tous les niveaux : du religieux (Gottlieb 2004, Daugey, Razy et Campigotto 2020), au médical (Figueiredo 2019), en passant par la parenté (Sarcinelli et al. 2022 ; Razy, Alvarado Solis et de Suremain 2024), et l’âge (Salgues 2024). Force est de constater que l’anthropologie de l’enfance s’est davantage développée comme un champ de recherche minoritaire et minorisé, resserré sur lui-même et sur l’entre-soi du groupe de pairs (Cohn, 2013, p. 223 in Cruz Rifiotis ibid).
Plus que le manque de légitimité de l’anthropologie parmi les disciplines qui étudient et produisent un savoir sur l’enfance, le problème le plus insidieux est interne à la discipline, il s’agit de ce que Scheper-Hughes & Sargent (1998 : 14) appellent « l’herméneutique de la suspicion » qui pèse sur la parole des enfants et leur crédit comme informateurs. Le travail avec les enfants, pour la majorité des anthropologues, est davantage du ressort de la psychologie, de la psychanalyse ou des sciences de l’éducation. Comment donc sortir de cette impasse et répondre à l’intuition de Mauss, et aussi celle de F. Héritier (2017), selon laquelle étudier les enfants permet traiter de questions plus générales : le corps, le genre, la parenté ?
Le présent numéro réunira des contributions éclairant la façon dont l’enfance aide à penser des questions anthropologiques plus générales et, en miroir, comment des théories générales peuvent aider à penser l’enfance. Ce sera l’occcasion de présenter différentes traditions anthropologiques nationales qui ont déjà cherché à inscrire les enfants au cœur de la discipline au-delà des sous-champs disciplinaires. Le numéro questionnera également la portée heuristique d’une anthropologie à partir des enfants d’un point de vue méthodologique d’une part, théorique et épistémologique d’autre part. Car inscrire les enfants au cœur de l’anthropologie ne revient pas à impliquer les enfants pour comprendre l’enfance, mais inclure les enfants dans notre compréhension du monde social dans son ensemble.
Comment des anthropologues ont cherché à rompre avec le paradigme de production de connaissance par, pour et sur des hommes adultes ? Comment le fait d’investir les questions autour de l’enfant et de l’enfance influence la vision même de l’anthropologie ? Et comment cette question se pose différemment en fonction de l’univers académique d’affiliation, qu’il soit au Nord ou au Sud, avec une production dans une langue plus ou moins dominante et en fonction des divisions disciplinaires ? Telles sont les questions qui seront traitées dans ce numéro. Il s’agira de décloisonner tant les méthodes d’enquête que les théories autour de l’enfant devenu « grand sujet » de l’anthropologie.
Bibliographie
Ariès P., 1960, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Plon.
Becchi E., Julia D. (dir.), 1998, Histoire de l’enfance. Tome I : De l’Antiquité au XVIIe siècle. Tome II : Du XVIIIe à nous jours, Paris, Seuil.
Bonnet D., 2012, « The absence of the child in ethnology : A non-existent problem ? » Anthropochildren, 1, [En ligne], URL : http://popups.ulg.ac.be/2034-8517/index.php?id=121 consulté le 15/10/2012.
Cohn C. 2013, “Concepções de infância e infâncias. Um estado da arte da antropologia da criança no Brasil”, Civitas: Revista de Ciências Sociais, Porto Alegre, v. 13, p. 211-234, 2013. DOI : 10.15448/1984-7289.2013.2.15478.
Daugey M., Razy É., Campigotto M., 2020, “Les enfants dans les rites. Des sujets, des acteurs ou des objets ?”, L’Homme. Revue française d’anthropologie, Vol. 234-235, pp. 51-70.
Cruz Rifiotis F., Bittencourt Ribeiro F., Cohn C. e Schuch P., 2021, « A antropologia e as crianças: da consolidação de um campo de estudos aos seus desdobramentos contemporâneos», Horizontes Antropológicos [Online], 60 | 2021, posto online no dia 12 agosto 2021, consultado o 31 outubro 2023. URL: http://journals.openedition.org/horizontes/5313.
Dasen V., Lett D., Morel M.F., Rollet C., 2001, « Enfances. Bilan d’une décennie de recherche », Annales de démographie historique, 102, 2.
DeMauseL., 1974, The History of Childhood, London, Aronson.
Figueiredo C., 2019, « Le corps adolescent face à la souffrance psychique : enjeux individuels, sociaux et politiques de l’hospitalisation en pédopsychiatrie. », Enfances Familles Générations [En ligne], 33 | 2019, mis en ligne le 30 septembre 2019 URL :
Gottlieb A. 2004, The afterlife is where we come from: the culture of infancy in West Africa, Chicago, University of Chicago Press.
Hirschfeld L.A., 2003, « Pourquoi les anthropologues n’aiment-ils pas les enfants ? », Terrain, 40, p. 21-48.
Lallemand S., Le Moal G., 1981, « Un petit sujet », Journal des Africanistes, 51, 5-21.
Lenclud G., 2003, « Apprentissage culturel et nature Humaine », Terrain, 40, p. 5-20.
Malinowski B., 1927, Sex and Repression in Savage Society, London, Paul, Trench, Trubner.
Malinowski B., 1929, The Sexual Life of Savages in North Western Melanesia, London, Routledge.
Mauss M., Fournier M., 1996, “Trois observations sur la sociologie de l’enfance”, Gradhiva : revue d’histoire et d’archives de l’anthropologie, 20, 108-115. DOI: https://doi.org/10.3406/gradh.1996.912.
Mead M., 1928, Coming of age in Samoa, New York, William Morrow.
Pollock L., 1983, Forgotten Children: Parent-Child Relations from 1500-1900, Cambridge, Cambridge University Press.
Razy E., Alvarado Solis N.P., de Suremain C-E., 2024, “Revisiter le champ de la parenté à partir de l’anthropologie de l’enfance et des enfants”, Anthropochildren (Special Issue), 12.
Salgues C., 2024, Une après-midi à Shanghai : l’enfance et la question anthropologique de l’âge, Genève, Éditions ies, Haute étude de travail social, col. « Le geste social ».
Sarcinelli A. S., Martial A., Martin A., 2022, “Présentation : Enfants et descendants, des acteurs de la parenté”. Anthropologie et sociétés, 46, 2, 11-20.
Scheper-Hughes N., Sargent C., 1998, Small wars: the cultural politics of childhood, Berkeley, University of California Press.
Teixeira M., 2019, « L’interdisciplinarité en santé dans le champ de la petite enfance : un point de vue anthropologique », L’Autre, 3, 20, 263-271. DOI : 10.3917/lautr.060.0263. URL : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-l-autre-2019-3-page-263.htm
Tinat, Karine, 2017, « Le dernier entretien de Françoise Héritier », Socio, 9, pp.238-255.
Viazzo P., 2004, « Abandonment », dans FASS P.F. (dir.), Encyclopedia of Children and Childhood [in History and Society], 1, New York, Macmillan, p. 1-3.
Zelizer V.A.R., [1985] 1994, Pricing the priceless child: the changing social value of children, Princeton, Princeton University Press.
